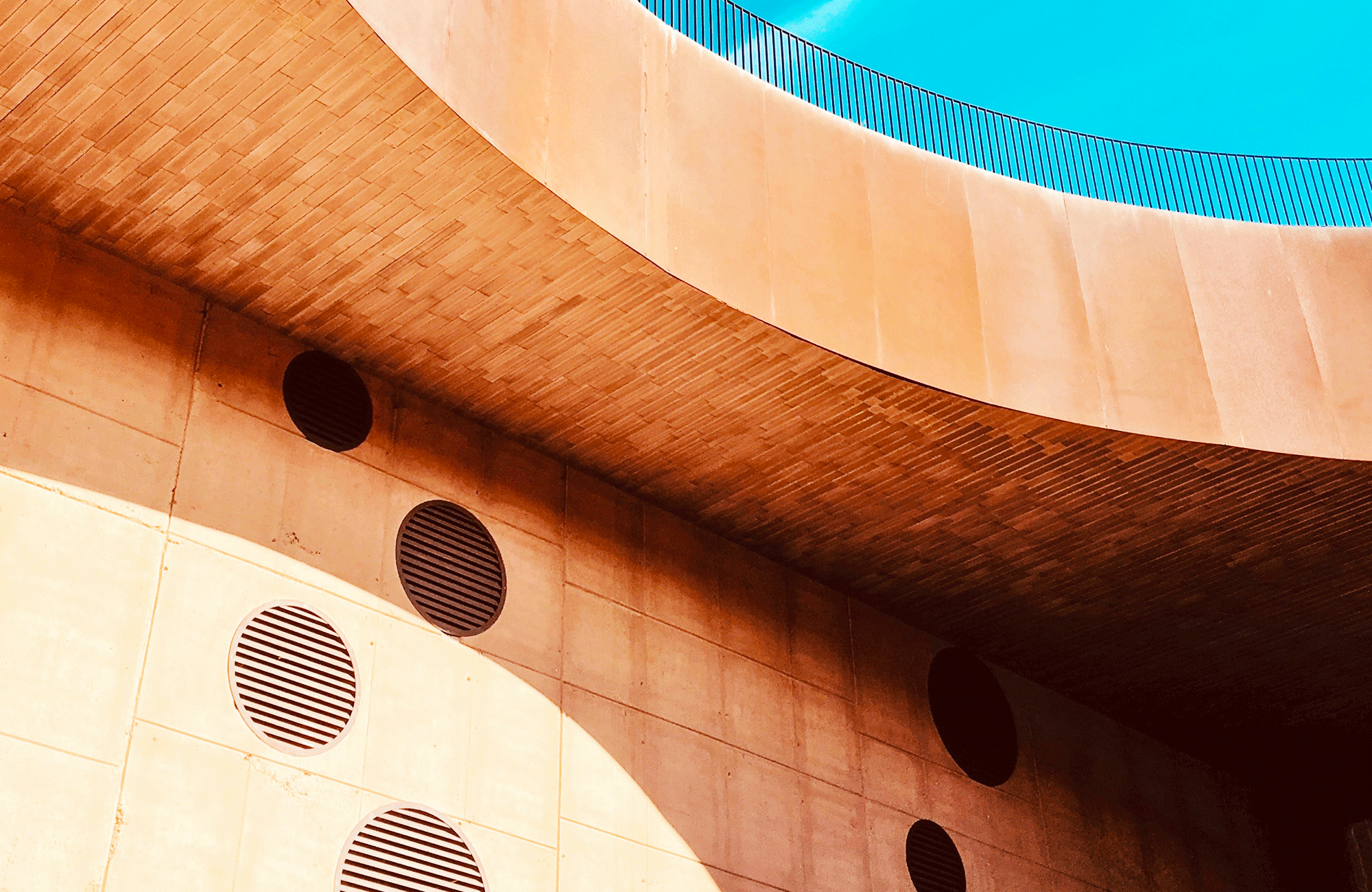L’employeur peut-il modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés par un salarié ?
Oui l’employeur peut modifier les dates des congés payés d’ores et déjà posés par ses salariés sous réserve de respecter, le cas échéant, un certain délai de prévenance qui est fixé :
– Par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par la convention collective de branche (Article L. 3141-15 du code du travail) ;
– A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, le délai sera d’un mois minimum avant la date de départ prévue ; exception faite de « circonstances exceptionnelles » pour lesquelles aucun délai n’est imposé (Article L. 3141-16 du code du travail).
Le COVID-19 est-il une circonstance exceptionnelle ?
La Code du travail ne précise pas la notion de « circonstances exceptionnelles » mais la jurisprudence admet que des raisons économiques telles les nécessités impératives de livraisons (Cass. soc., 17 juillet 1989, n°89-43.310) ou encore le remplacement d’un salarié décédé (Cass. soc., 15 mai 2008, n°06-44.354) puissent caractériser de telles circonstances.
Au regard de la gravité de la situation sanitaire actuelle, on pourrait arguer des conséquences préjudiciables de l’épidémie sur le fonctionnement de l’entreprise pour justifier de circonstances exceptionnelles. Cela d’autant que Ministère du travail a lui-même fait référence à l’existence de circonstances exceptionnelles en évoquant la possibilité, pour l’employeur, « de déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir la période de 14 jours [correspondant à la première période de confinement], compte tenu des circonstances exceptionnelles en application de l’article L. 3141-16 du code du travail ». (Circulaire QR du 9 mars 2020 – Coronavirus – COVID 19, QR 21).
A titre d’exemple, deux semaines de vacances planifiées début mai pourraient ainsi être avancées fin mars, sans que le salarié ne puisse dès lors s’y opposer.
A contrario, l’employeur peut-il imposer au salarié, qui n’aurait pas posé de congés payés, d’en prendre ?
A ce jour, l’employeur ne peut pas imposer à un salarié de prendre ses congés payés pour faire face à la crise sanitaire ; seule une modification des congés déjà posés pouvant être imposée pour circonstances exceptionnelles.
Cette position est également celle du Ministère du travail (Circulaire QR du 9 mars 2020 – Coronavirus – COVID 19, QR 21).
Néanmoins, la réponse devrait évoluer vers plus de flexibilité dans les prochains jours.
En effet, l’article 7-7 de la « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid -19 », adoptée par le Parlement le 22 mars 2020, autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des dispositions permettant aux entreprises d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés en dérogeant notamment aux délais de prévenance.
Cette faculté devra être :
– Prévue par un accord d’entreprise ou de branche ;
– Limitée à 6 jours ouvrables.
En tout état de cause, et dans l’attente de la future ordonnance, rien n’interdirait à l’employeur de proposer au salarié de prendre des congés payés dans les prochains jours ; et de procéder d’un commun accord.
Cette faculté peut être intéressante pour gérer la situation de salariés provisoirement bloqués à l’étranger (exclusivement pour des raisons personnelles), sans pouvoir mettre en place du télétravail ; et qui, à défaut, se trouveraient en absence injustifiée et donc sans rémunération (Cass. soc., 17 novembre 1977, n°76-40.966 ; Cass. soc., 10 juin 2008, n°06-46.000).
Un salarié peut-il annuler ses congés payés notamment pour bénéficier du régime de l’activité partielle et conserver ainsi son solde de congés ?
Non, un salarié n’a pas la faculté d’annuler unilatéralement des congés payés d’ores et déjà posés, cela sous réserve d’éventuelles règles contraires applicables au niveau de l’entreprise.
En application de l’article L. 3141-16 du Code du travail, l’employeur peut donc refuser une demande d’annulation de ses congés payés formulée par un salarié, ces derniers devant alors être maintenus.
Qu’en est-il pour les JRTT ? Un employeur peut-il imposer la prise de JRTT ?
La faculté, pour l’employeur, d’imposer à ses salariés la prise de JRTT dépend, en principe, de la rédaction et des modalités prévues par l’accord collectif d’aménagement du temps de travail (délai de prévenance, modalités d’information, etc …).
En effet, le Ministère du travail rappelle que ces accords peuvent « fixer des JRTT à la libre disposition de l’employeur, le délai de prévenance et les modalités de modification du calendrier de prise. Les JRTT à la libre disposition de l’employeur peuvent être positionnés librement par celui-ci au cours de la période de référence. Si l’employeur souhaite modifier leur positionnement en cours de période, il doit le faire en respectant le délai prévu par l’accord collectif. » (Circulaire QR du 9 mars 2020 – Coronavirus – COVID 19, QR 21).
Néanmoins, l’article 7-8 de la « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des dispositions permettant aux entreprises d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail.
Cette faculté est également étendue aux :
– Jours de repos prévus par les conventions de forfait
– Jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.
Jacques Perotto, Benoît Dehaene, Arielle Duchène et Quentin Kéraval, avocats en droit social