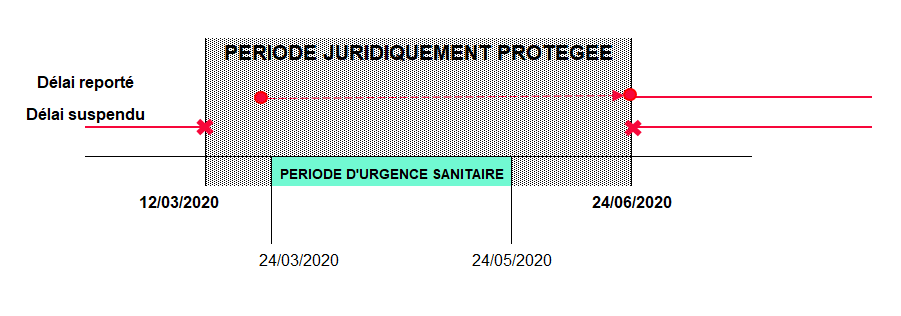Entre survie des entreprises et santé des salariés, le Covid-19 donne une nouvelle occasion aux patrons et syndicats de se confronter sinon de s’affronter : chiffon rouge du droit de retrait agité si les conditions de sécurité ne sont pas assurées dans l’entreprise et préavis de grève déjà déposés en anticipation d’une contestation de ce même droit de retrait par l’employeur.
Si la bonne volonté ne manque pas du côté des entreprises pour mettre en place les mesures barrières et de distanciation sociale, les incertitudes demeurent grandes, liées en cela à l’étendue de leur responsabilité en cas d’infection d’un salarié par le Covid-19 ; incertitudes également liées aux conditions de propagation de la maladie, à l’absence de vaccin et sans doute enfin aux atermoiements gouvernementaux sur le port du masque et la pratique des tests dans les entreprises.
Les décisions de justice récentes rendues à propos du Covid-19 sont là pour nous rappeler que malgré les incertitudes rappelées, l’employeur doit remplir son obligation de moyens pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés ; petit tour d’horizon de ce qu’il faudrait faire … et surtout ne pas faire.
Le Covid-19 impose-t-il obligatoirement une mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER) ?
Rappel de quelques principes :
– Le Covid-19 n’est pas une maladie professionnelle en soi : en effet, hormis pour le personnel soignant régulièrement exposé au risque pour lesquelles des annonces ministérielles ont été faites, le Covid-19 n’est pas une maladie professionnelle à condition que l’employeur ait bien mis en place les mesures nécessaires et en particulier celles découlant du protocole de déconfinement et celles résultant des fiches métiers du Ministère du travail.
– En revanche, les juges ont déjà admis la prise en charge d’une pathologie lorsqu’elle a pour origine un ou plusieurs événements déclencheurs, survenus à des dates « certaines », en lien avec le travail, peu important le temps écoulé entre cet évènement et l’apparition de la lésion (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 et Cass. 2e civ., 6 octobre 2016, n°15-25.924 pour la vaccination contre l’hépatite B).
La reconnaissance d’un accident du travail supposerait de pouvoir déterminer l’événement à l’origine de la contamination au Covid-19, comme un contact étroit et/ou prolongé avec un autre salarié, l’employeur ou encore un client, à l’occasion d’un rendez-vous, entretien, d’une livraison, du travail dans un open-space ou dans un atelier …
– Le seul constat d’une contamination au Covid-19 ne sera pas suffisant pour que puisse être engagée la responsabilité civile ou pénale de l’employeur ; elle pourra l’être si et seulement si l’évènement à l’origine de la contamination est identifié et si le dispositif de sécurité adéquat n’a pas été mis en place par l’employeur.
– La première traduction du respect de ces dispositifs doit s’effectuer au travers du DUER ; son absence de mise à jour ou son absence tout court, fait encourir à l’employeur une responsabilité de principe en cas d’infection de l’un de ses salariés.
L’article R. 4121-2 du Code du travail prévoit en effet que tout employeur souhaitant poursuivre ou reprendre son activité doit (i) mettre à jour son DUER pour tenir compte de l’épidémie de Covid-19 et (ii) procéder, autant qu’il est nécessaire, à son actualisation pour tenir compte des changements intervenus : évolution de l’épidémie, matériel de protection disponible, avancée des connaissances médicales, préconisations des autorités sanitaires, etc…
Ainsi, le DUER doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, y compris notamment les équipements de travail, l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et la définition des postes de travail.
La décision rendue contre Amazon France Logistique a ordonné qu’il soit procédé « à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts » avec une réduction imposée de son activité aux produits essentiels, sous astreinte de 1.000.000 d’euros par jour de retard et infractions constatées (TJ Nanterre, 14 avril 2010 « Amazon », n°20/00503).
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Versailles qui rappelle entre autres l’impérieuse nécessité d’actualisation du DUER sur les risques professionnels liés au Covid-19 (CA Versailles, 24 avril 2020 « Amazon », n°20/01993).
De la même manière, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné à La Poste d’élaborer et de diffuser le DUER à jour du Covid-19, après avoir relevé « qu’aucun document de ce type n’existe encore au sein du Groupe La Poste », et ce malgré un effort d’évaluation jugé « suffisamment accompli » (TJ Paris, 9 avril 2020 « La Poste », n°20/52223).
A quelles sanctions s’expose l’employeur qui ne procède pas régulièrement à l’actualisation du DUER ?
L’article R. 4741-1 du Code du travail dispose notamment que : « Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ».
Sur le fondement de l’obligation de sécurité, et comme ce fut le cas pour Amazon, un employeur peut être condamné à restreindre, voir arrêter, ses activités le temps qu’il soit procédé à la mise à jour du DUER, le cas échéant, sous astreinte (TJ Nanterre, 14 avril 2010 « Amazon », n°20/00503).
Une mise à jour du règlement intérieur est-elle aussi nécessaire ?
Oui, il est possible, voire souhaitable selon les situations, de procéder à une mise à jour du règlement intérieur pour prendre en compte, non seulement l’épidémie de Covid-19, mais également les mesures de prévention complémentaires adoptées par l’entreprise.
Au-delà de contenir, par nature, des dispositions relatives à la santé et la sécurité, le règlement intérieur est le support du droit disciplinaire et prévoit notamment l’échelle des sanctions disciplinaires applicables, dont celles qui pourront être prises, le cas échéant, en cas de comportement contraire aux nouvelles règles de sécurité.
Conjointement, est-il nécessaire de mettre à jour les plans de prévention relatifs aux prestataires extérieurs ?
Oui, il est impératif pour tout employeur qui souhaite poursuivre ou reprendre son activité de mettre à son jour ses plans de prévention relatifs aux prestataires extérieurs en intégrant les risques spécifiques à l’épidémie de Covid-19.
A titre d’exemple, pour les transporteurs « les opérations de chargement et de déchargement doivent faire l’objet d’un document écrit comprenant les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer » (TJ Nanterre, 14 avril 2020 « Amazon » n°20/00503 ; également TJ du Havre, 7 mai 2020 « SAS Renault », n°20/00143).
Quels sont les partenaires devant être associés à la mise à jour du DUER ?
La circulaire DRT n°2002-6 dispose que l’employeur doit associer les « acteurs internes à l’entreprise » dans le processus d’élaboration et de mise à jour, du DUER, à savoir :
– Les instances représentatives du personnel, principalement le CSE et, le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ou son équivalent.
– Le médecin du travail qui contribue plus particulièrement à la démarche de prévention ;
– Dans la mesure du possible, les salariés eux-mêmes.
En conséquence, et comme l’a relevé la Cour d’appel de Versailles, « la règlementation n’impose pas de méthode particulière pour procéder à l’évaluation des risques professionnels, la méthode retenue doit permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés aux dangers. » (CA Versailles, 24 avril 2020 « Amazon », n°20/01993)
Amazon et Carrefour Hypermarchés ont été ainsi condamnés pour ne pas avoir associé les représentants du personnel dans l’actualisation du DUER aux motifs que :
– Le CSE a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et qu’il doit notamment être consulté en cas de modification importante de l’organisation de travail ;
– La pertinence de l’évaluation des risques repose sur la prise en compte de situations concrètes de travail, les salariés, par le prisme des représentants du personnel, disposant des connaissances et de l’expérience de leur propre situation de travail et des risques engendrés.
En conséquence, il est donc (i) impératif d’associer le CSE dans l’actualisation du DUER et (ii) d’adopter « une approche pluridisciplinaire » en convoquant des compétences médicales (notamment le médecin du travail), techniques et organisationnelles.
Une simple information a posteriori du CSE sera nécessairement jugée insuffisante.
Bien entendu, il est également indispensable de formaliser par écrit, dans un document, l’ensemble des actions menées (rédaction des PV, rédaction de comptes-rendus, etc …) ; à défaut il pourrait être reproché à l’employeur ne pas avoir associé les représentants des salariés et en premier lieu le CSE (CA Versailles, 24 avril 2020 « Amazon », n°20/01993).
En cas de refus ou de retard du secrétaire dans la rédaction des PV, il est fortement conseillé à l’employeur de procéder par voie de mise en demeure, le cas échéant, avec l’Inspecteur du travail en copie. Le recours à un sténographe peut aussi être envisagé.
Quelles sont les principales implications du Covid-19 en termes d’évaluation des risques professionnels et des mesures de prévention afférentes ?
Les premières décisions de justice sur le sujet permettent de donner un éclairage des attentes spécifiques au Covid-19 et du modus operandi, bien que celles-ci soient propres à chaque entreprise en fonction notamment de son activité, de ses spécificités et de ses contraintes.
D’une manière générale, l’employeur doit identifier l’ensemble des situations de travail susceptibles d’occasionner un risque de transmission du Covid-19 de l’entrée à la sortie de l’entreprise en se posant notamment les questions suivantes :
– Est-ce que l’organisation du travail telle qu’elle existait avant la crise sanitaire est compatible avec les contraintes liées à la distanciation sociale ?
– Si tel n’est pas le cas, comment réorganiser son activité pour tenir compte de ces nouvelles contraintes ? Ces évolutions seront à mentionner dans le DUER.
– Lorsque l’organisation de certains postes de travail est incompatible avec le strict respect des exigences de distanciation sociale ; doit-on interdire purement et simplement le travail sur ces postes ?
Ainsi, tout employeur qui souhaite poursuivre ou reprendre son activité devra intégrer dans ses mesures d’évaluation et de prévention les risques professionnels liés :
– Aux modalités d’entrée et de sortie des salariés au sein de l’entreprise qui pourraient représenter une source de contamination résultant notamment d’un afflux trop important de salariés ou de dispositifs de sécurité compromettant les règles de distanciation sociale.
C’est ainsi qu’Amazon a dû procéder à une évaluation plus poussée et prendre les mesures de prévention adéquates pour son dispositif de portiques magnétiques contrôlant l’entrée et la sortie du site alors qu’entre 150 à 450 salariés prenaient leur poste en même temps.
– Aux relations avec les collègues de travail et les clients se traduisant, notamment en matière de prévention, par le respect des gestes barrières et la mise à dispositions de gels hydroalcooliques ou de points d’eau avec savon pour procéder à un lavage des mains.
– Aux modalités d’utilisation de l’ensemble des équipements mis à la disposition des salariés, notamment l’utilisation des vestiaires, des douches, des sanitaires, des salles de pause, des salles déjeuner ; ces endroits devant a minima faire l’objet de procédure particulière de nettoyage et permettre de respecter les règles de distanciation sociale (TJ du Havre, 7 mai 2020 « SAS Renault », n°20/00143 en matière de restauration).
En cas de restriction d’usage de certains de ces équipements, il conviendra d’être vigilant à ne pas générer de nouveaux risques de contamination. A titre d’exemple, en limitant l’accès aux vestiaires, Amazon a créé un nouveau risque lié rangement des manteaux « les uns à côté des autres sur des rambardes à proximité de leur poste de travail ».
– Aux conditions et modalités d’utilisation des matériels, outils professionnels, matières premières, marchandises, etc … ; des protocoles de manipulation et de nettoyage suffisamment précis devant être arrêtés et formalisés par écrit par l’employeur.
– A la gestion des cas d’infections signalés, avérés ou suspectés, tant en ce qui concerne les salariés que les locaux et le mobiliers (définition d’une procédure précise de gestion des salariés contaminés ainsi que des personnes ayant été en contact avec eux, définition d’une procédure de nettoyage des locaux et des surfaces de travail …).
S’agissant des mesures de prévention, le Conseil d’état a jugé que « l’absence de distribution systématique de masques aux salariés ne révèle pas, compte tenu des moyens dont dispose l’administration et des mesures qu’elle a déjà mises en œuvre, de carence grave et manifestement illégale » (CE, 18 avril 2020 « Fermeture des entreprises de la métallurgie », n°440012).
Ainsi, l’absence de fourniture de masques aux salariés n’est pas de nature à caractériser, de ce seul fait, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; même si le recours à ce type d’équipement apparaît nécessaire pour certains emplois.
Le Covid-19 est-il un risque biologique ?
Dans certains cas, oui. Le Code du travail comporte, aux articles L. 4421-1 et R. 4421-1 à R. 4427-5 des mesures de prévention spécifiques applicables aux « établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques », telles la mise en œuvre de mesures de protections collectives et individuelles particulières ou encore la tenue d’un registre spécifique répertoriant notamment les activités sensibles, les travailleurs exposés, le plan d’urgence.
Selon le Ministère du travail, peuvent être considérés comme exposés au risque biologique au titre du Covid-19 :
– Les professionnels systématiquement exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (ex : professionnels de santé et de secours) ;
– mais également les travailleurs dont les fonctions les exposent à un risque spécifique quand bien même l’activité de leur entreprise n’impliquerait pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique. Cette situation peut notamment concerner les travailleurs des secteurs des soins, de l’aide à domicile ou des services à la personne, dès lors que leurs tâches impliquent des contacts de moins d’un mètre avec des personnes potentiellement contaminées (ex : toilette, habillage, nourriture). »
C’est dans ce contexte que le Tribunal judiciaire de Lille a jugé, dans trois affaires distinctes, que l’exposition des salariés au Covid-19 constitue un risque biologique impliquant le respect des dispositions plus coercitives relatives à cette qualification. Bien que les activités en cause n’impliquaient pas, par nature, l’utilisation délibérée d’un agent biologique, la juridiction a relevé, que les employeurs avaient explicitement identifié ce risque au sein de leur DUER (TJ Lille, 3 avril 2020 « Association ADAR Flandres Métropole », n°20/00380 ;, 14 avril 2020 « Carrefour Market », n°20/00386 ; 24 avril 2020 « Carrefour Hypermarchés », n°20/00395).
Plus récemment, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rejeté l’application de cette règlementation dans le secteur de la boulangerie (TJ, Aix-en-Provence, 30 avril 2020, n°20/00365) alors que celui du Havre l’a également rejeté dans le secteur de l’industrie automobile (TJ du Havre, 7 mai 2020 « SAS Renault », n°20/00143).
Il convient donc d’être particulièrement vigilant dans la mise à jour de sa DUER et dans la qualification juridique des risques induits par l’épidémie de Covid-19 sous peine de se voir appliquer de facto les dispositions coercitives liées à la prévention des risques biologiques.
L’employeur doit-il porter une attention spécifique aux risques psychosociaux (RPS) ?
Oui, l’épidémie de Covid-19 constitue indéniablement un facteur supplémentaire de RPS que les employeurs ne doivent évidemment pas négliger dans la mise à jour de leur DUER (TJ Paris, 9 avril 2020 « La Poste », n°20/52223 ; CA Versailles, 24 avril 2020 « Amazon », n°20/01993 ; (TJ du Havre, 7 mai 2020 « SAS Renault », n°20/00143).
L’évaluation des RPS doit notamment prendre en compte :
– Le risque épidémique en lui-même en ce qu’il est facteur de stress et d’inquiétude pour les salariés, notamment ceux poursuivant leur activité professionnelle ; ce risque perdurera tant que le virus sera présent.
– D’autre part, les conséquences de la réorganisation de l’entreprise et les changements organisationnels (modification des plages de travail, travail à distance, contraintes liées aux règles d’hygiène, incertitude professionnelle, etc …).
L’employeur doit-il informer les salariés des risques identifiés et des mesures de prévention adoptées ?
Oui, l’employeur doit procéder à une information individuelle, régulière, précise et intelligible des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (Article R. 4141-1 du Code du travail).
Cette information peut notamment prendre la forme de notes internes, d’affichages dans les locaux, d’infographies, etc …
A titre d’exemple, le Tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné à l’ADAR Flandre Métropole de procéder à plusieurs informations spécifiques sur les procédures particulières mises en œuvre, telle l’interdiction de se rendre chez un client sans être munis des équipements de sécurité nécessaires (TJ Lille, 3 avril 2020 « Association ADAR Flandres Métropole », n°20/00380).
L’employeur doit-il prévoir des mesures de formation spécifique des salariés ?
Oui, il est bien entendu indispensable pour l’employeur d’assurer la formation des salariés au respect des nouvelles règles de sécurité adoptées pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Il ressort des premières décisions qu’il convient notamment d’assurer la formation des salariés sur l’utilisation (port, retrait, nettoyage, stockage) des équipements de protection (gants, masques, combinaison …), sur les gestes barrières, sur la procédure en cas de suspicion d’exposition ou d’exposition avérée au Covid-19.
Selon, le Tribunal judiciaire du Havre les programmes de formation doivent être préalablement soumis au CSE pour consultation (TJ du Havre, 7 mai 2020 « SAS Renault », n°20/00143).
Il conviendra, bien entendu, d’intégrer une dimension hiérarchique dans les formations dispensées, les managers devant être spécifiquement formés à la gestion de cette situation de crise.
Est-il nécessaire de décliner un Plan de continuation d’activité (PCA) ou de reprise d’activité (PRA) ?
Le PCA est un outil, sans existence ni reconnaissance légale, qui a pour objectif de décliner une stratégie dans un contexte de crise afin d’assurer la continuité de l’activité d’une entreprise en période de crise, telle l’épidémie de Covid-19. Ce document peut notamment évoquer :
– La mise en place d’une structure de crise ;
– L’identification des perturbations possibles et des postes-clés au maintien de l’activité ;
– La réorganisation de la production (télétravail, changements des horaires, des affectations, organisation de la polyvalence…) ;
– Les mesures d’hygiène, santé, sécurité et de prévention des risques.
Contribuant à renforcer l’intérêt d’établir un PCA dans le contexte actuel, la note du 30 mars 2020, rédigée par la DGT à l’attention des DIRECCTE, indique, à titre d’exemple, que l’Inspecteur du travail peut demander à l’employeur, lors d’un contrôle, la communication de « son plan de continuation de l’activité (PCA) ».
Selon une étude menée en mars et avril derniers par l’ANDRH auprès de 550 DRH, 33 % des entreprises sondées disposaient d’un PCA dédié à la pandémie avant le 16 mars 2020 (début du début du confinement) et 39 % en ont mis un en œuvre à partir de cette date.
Jacques Perotto, Benoît Dehaene et Quentin Kéraval, Avocats en droit social.