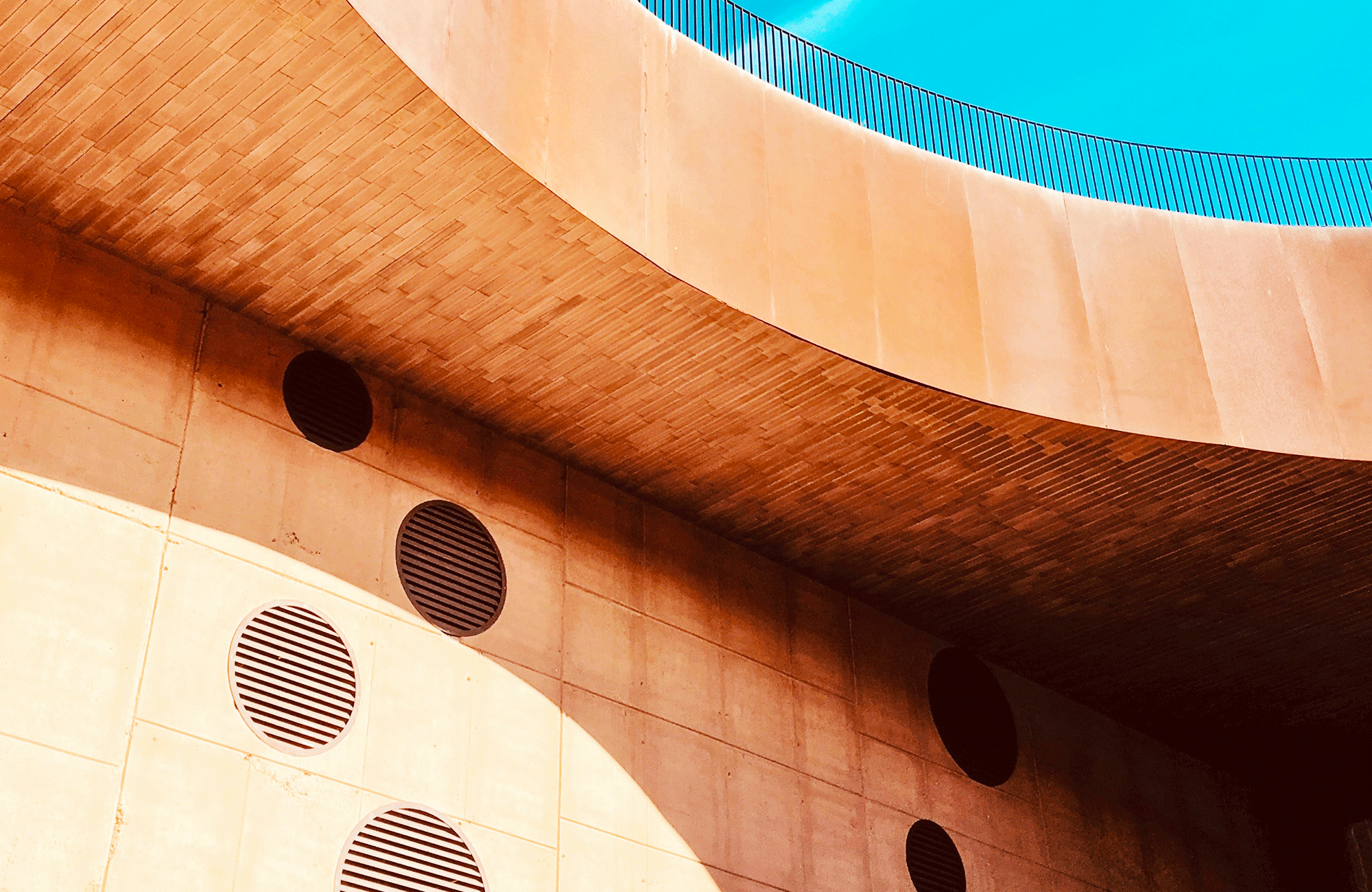Le 11 avril 2019, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), dont la publication au Journal Officiel, retardée en raison d’un recours toujours pendant devant le Conseil constitutionnel portant sur un autre aspect spécifique du texte, devrait intervenir d’ici l’été.
Parmi les 74 mesures présentées qui constituent un véritable arsenal de dispositions visant à simplifier la vie des entreprises de leur création à leur liquidation, plusieurs dispositions sont relatives à la propriété industrielle et tendent à rendre le brevet français plus attractif pour donner aux entreprises françaises davantage de moyens d’innover.
Voici brièvement ce qu’il faut en retenir :
1- Renforcement du certificat d’utilité comme alternative crédible au brevet
Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) conférant un monopole d’exploitation sur une invention pour une période maximale de six ans. Jusqu’à présent, seule la demande de brevet était convertible en une demande de certificat d’utilité, la réciproque étant impossible.
Le nouvel article 40 de la loi PACTE modifie l’article L. 612-15 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) en prévoyant désormais :
• la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en une demande de brevet si l’invention de l’entreprise concernée requiert davantage de protection, engageant alors la nécessaire réalisation d’un rapport de recherche ;
• l’allongement de la durée de vie du certificat d’utilité à dix ans.
L’objectif poursuivi par le législateur est de considérer le certificat d’utilité comme une alternative crédible et moins onéreuse que le brevet, même si un tel titre de propriété restera toujours moins valorisable, en raison de l’absence de tout rapport de recherche préalable et d’examen au fond par l’INPI.
2 – Critère d’activité inventive enfin examiné par l’INPI
L’examen au fond par l’INPI jusqu’ici en vigueur d’une demande de brevet était uniquement limité à l’appréciation du critère de la nouveauté, et non à celui déterminant de l’activité inventive. Pour cette raison, le brevet français pouvait être considéré comme un brevet « faible » par rapport au brevet européen ou à d’autres brevets nationaux.
La loi PACTE, en modifiant l’article L 612-12 du Code de propriété intellectuelle (CPI), renforce l’examen au fond réalisé par l’INPI, en lui offrant désormais la possibilité de rejeter une demande de brevet tant pour défaut de nouveauté que pour défaut d’activité inventive.
3- Mise en place d’une nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI pour améliorer la qualité et la valeur économique des brevets français
Seul le recours judiciaire était envisageable en cas de contestation d’une décision de délivrance d’un brevet par l’INPI qui pouvait facilement aboutir à l’annulation du brevet, celui-ci n’ayant alors pas fait l’objet en amont d’un examen au regard du critère de l’activité inventive en sus du critère de la nouveauté. A titre comparatif, l’Office européen des brevets (OEB) met en effet déjà en place une procédure d’opposition à l’encontre des demandes de brevets européens, tout comme la plupart des offices nationaux de propriété industrielle au sein de l’Union Européenne ou de pays tiers (Etats-Unis, Japon, Australie).
Désormais, le nouvel article 42 de la loi PACTE offre aux tiers la possibilité d’un recours administratif à l’encontre des brevets délivrés par l’INPI permettant ainsi un alignement du droit français avec la pratique d’une majorité d’offices étrangers.
Outre le fait que cette nouvelle procédure administrative est plus simple, plus courte et moins coûteuse que le recours judiciaire pour celui qui en est à l’initiative, elle contribue également à renforcer la qualité et la valeur économique des brevets français.
4- Modification de la prescription des actions en contrefaçon et en nullité
Tout d’abord, le nouvel article 42 quinquies de la loi PACTE prévoit ainsi un changement important : l’action en nullité des brevets, des marques, des dessins et modèles ou encore des certificats d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription.
A ce titre, les parlementaires français ont à la fois souhaité corriger une difficulté juridique et anticiper sur l’évolution du droit européen, notamment en matière de brevet européen à effet unitaire, en alignant le brevet français à ses exigences spécifiques.
Jusqu’à présent, l’action en nullité d’un brevet, enfermée dans un délai de cinq ans depuis la réforme du 17 juin 2008, entraînait une certaine insécurité juridique pour les titulaires de droits, notamment concernant le point de départ de son délai, fruit de nombreuses décisions divergentes ces dernières années. L’applicabilité de cette prescription quinquennale aboutissait également à l’impossibilité, une fois passé ce délai, d’agir en nullité de brevets ne satisfaisant pas les conditions légales de brevetabilité, dont celle de l’inventivité non examinée par l’INPI.
L’article 13 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet prévoyait d’ores et déjà l’imprescriptibilité d’une action en nullité d’un brevet, afin de transposer en droit français les deux règlements de l’Union européenne formant le « Paquet Brevet » sur le brevet unitaire du 17 décembre 2012 et l’Accord précité sur la juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013. Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions dépend de la ratification de l’Accord par l’Allemagne qui reste à ce jour incertaine en raison d’un recours pendant devant la Cour constitutionnelle allemande.
Ainsi, la loi PACTE s’inscrit dans cette logique en supprimant tout délai de prescription de l’action en annulation d’un titre de propriété industrielle. Dès lors, les droits de propriété industrielle pourront toujours être remis en cause, créant une insécurité juridique pour les titulaires de droits et un possible affaiblissement de la valeur économique de leur innovation à long terme.
En second lieu, l’article 42 quinquies de la loi PACTE uniformise les règles de prescription quinquennale de l’action en contrefaçon de l’ensemble des droits de propriété industrielle, ainsi que du secret des affaires, et lève certaines incertitudes en modifiant le point de départ d’une telle action qui court désormais à compter « du jour où le titulaire d’un droit [ou le détenteur légitime] a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
Ces nouvelles dispositions pourraient être efficaces pour améliorer et renforcer l’indemnisation des préjudices résultant d’actes de contrefaçon à l’égard des titulaires de droits de propriété intellectuelle et des détenteurs légitimes de secrets des affaires.
5 – Création d’une demande provisoire de brevet pour simplifier l’accès au brevet
Cette étape préalable à la protection par le brevet pourrait être particulièrement utile pour les entreprises afin de leur simplifier l’accès au titre et d’en réduire le coût. La demande de brevet pourrait ainsi être complétée au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise, tout en gardant le bénéfice de l’antériorité de l’innovation.
A la suite du retrait de l’amendement qui proposait la création d’une demande provisoire de brevet limitée à 12 mois, le gouvernement a indiqué que ce nouveau type de demande serait mis en place par la voie règlementaire.
En conclusion, les apports de la loi PACTE permettent certes de favoriser et de protéger l’innovation des PME, des start-ups et de tous créateurs d’entreprises innovantes souvent confrontés à de nombreuses difficultés, et pourraient à terme renverser la tendance actuelle selon laquelle seulement 21% des PME en France déposent des brevets d’invention contre 57% de la part des grands groupes . Par comparaison, en Allemagne, pays connu pour son dynamisme en matière de propriété industrielle, les PME sont les premiers déposants de brevets avec une croissance toujours très régulière sur les 20 dernières années.
Toutefois, le succès du nouveau dispositif légal favorable mis en place en France dépendra des moyens mis en pratique à la disposition de l’INPI pour exercer sa mission à des coûts et dans des délais raisonnables pour les entreprises déposantes. A défaut, ce qui est annoncé comme étant un facteur d’innovation favorable au dépôt du brevet français risquerait d’avoir un effet inverse sur son attractivité recherchée.
Corinne Thiérache, associée et Alice Gautron, collaboratrice du Département Propriété Intellectuelle d’Alerion.